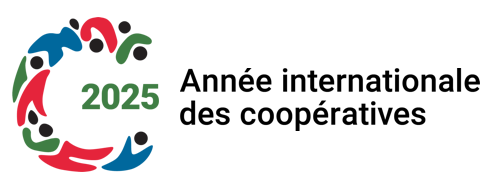LE CHOIX DE LA HVE

« Les pratiques locales de désherbage ont guidé le choix de la HVE »
À l'origine, la démarche engagée par la coopérative vinicole Sabledoc en faveur de l'agroécologie a été inspirée par son principal partenaire commercial pour les vins vendus en vrac. « La suggestion a eu un écho immédiat auprès du conseil d'administration de la coopérative car elle permettait à la fois de valoriser des pratiques vertueuses utilisées depuis longtemps dans le vignoble, et d'adopter une dynamique de progrès », explique Audrey Roulleau-Retailleau. Sur le territoire de cette coopérative en bordure de Méditerranée, les vignes ont la particularité d'être réellement implantées dans le sable : une attraction pour les touristes nombreux dans la région. Ce sol très meuble présente l'avantage de faciliter l'utilisation du désherbage mécanique entre les rangs et sur les rangs des vignes. Seuls quelques vignerons n'ayant pas de matériel spécifiquene pratiquent pas encore ce type de désherbage. Les producteurs sont également sensibilisés à la problématique de l'érosion des sols, en raison des nuages de sable soulevés par le mistral. « Autrefois, un paillage de joncs était utilisé. Aujourd'hui, ils sèment des couverts végétaux à base d'orge à l'automne. Ils sont détruits au printemps par broyage avec un effet engrais vert, ou pâturés par des moutons. Nous ne les maintenons pas toute l'année en raison de la problématique de stress hydrique et du risque de remontées d'eau salée. »
Un réseau de canaux contre les remontées de sel
Le choix de la certification HVE a été « une évidence » pour la coopérative Sabledoc car elle remplit assez facilement l'ensemble des exigences dès le départ : usage limité des produits phytosanitaires (notamment herbicides), gestion de l'eau, gestion de la fertilisation et biodiversité. « Les apports azotés ne dépassent jamais 50 unités par hectare en lien avec les besoins de la vigne et les limitations de la directive nitrates. Le vignoble est quadrillé d'un réseau de canaux appelés roubines permettant de lutter contre les remontées de sel. Cette présence de l'eau contribue à la biodiversité via la présence d'arbres et de bosquets notamment. Le plus gros challenge est la réduction des produits phytosanitaires sachant que nous avons trois traitements obligatoires contre la flavescence dorée. » En 2015, le référentiel HVE est appliqué chez une dizaine de vignerons membres du conseil d'administration, afin d'en vérifier la faisabilité et de déterminer les coûts. La chambre d'agriculture du Gard est sollicitée pour organiser une journée de formation pour les vignerons, financée par Vivéa, et réaliser des pré-audits avant l'intervention de l'organisme certificateur. Le coût de la certification est pris en charge par la coopérative. En parallèle, les prix d'achat du vin sont renégociés avec Grands domaines du littoral et s'appliquent pour tous les adhérents. « La notion d'effort collectif a été un levier important. Une synergie s'est mise en place au-delà même de la coopérative. Les vignerons sont satisfaits que leurs pratiques soient validées comme respectant l'environnement et ont envie d'aller plus loin,
par exemple avec la production biologique », souligne Audrey Roulleau- Retailleau.
La traçabilité pour des conseils ciblés
La chambre d'agriculture anime des groupes de veille sanitaire sur le secteur et propose un suivi de traçabilité avec l'outil « Mes p@rcelles ». Une vingtaine d'adhérents gère directement son compte individuel « Mes p@rcelles ». Pour tous les autres, la conseillère viticole de la coopérative dispose d'un accès multi-comptes avec la cartographie complète de la cave et gère la saisie des données. Cela lui permet d'apporter des conseils ciblés pour chaque situation (réduction de doses, choix de produits moins dangereux) et de calculer les indices de fréquence de traitement (IFT). « Notre dispositif a permis à 24 adhérents d'atteindre le niveau trois de la certification environnementale (ou HVE), ils représentent au moins 75 % des surfaces, déclare Audrey Roulleau-Retailleau. Notre objectif est de
certifier chaque année de nouvelles exploitations sachant que c'est plus difficile de progresser pour les double-actifs, ou les vignerons gérant de petites surfaces. »