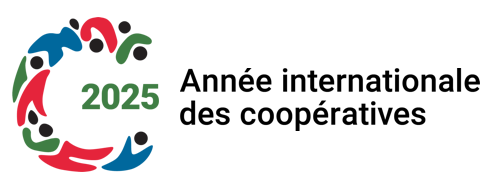DES SYSTÈMES COLLABORATIFS PLUS ÉCONOMES ET PLUS DURABLES


Dans les terres de craies de Champagne, les systèmes de culture sont en général fortement dépendants des apports en azote minéral, avec en moyenne 140 unités par hectare et par an. « Face à ce constat et au questionnement quant à la durabilité d’un tel schéma, il existe des réflexions collectives entre acteurs agricoles du territoire, mais les pratiques évoluent peu, constate Frédéric Adam. Nous nous sommes dit qu’il fallait travailler avec quelques agriculteurs en poussant la réflexion jusqu’au bout, afin que cela puisse servir d’exemple aux autres. » C’est ainsi qu’est né en 2014 le projet AUTO’N coordonné par la chambre d’agriculture du Grand-Est, avec les chambres départementales, l’Inrae, Agro-Transfert, les instituts techniques, l’enseignement et les coopératives agricoles Cérèsia et Vivescia. Son objectif est d’améliorer l’autonomie azotée des systèmes agricoles, en maintenant leur rentabilité et une production de qualité.
L’originalité du projet fut la coconstruction d’itinéraires techniques innovants en présence de sept agriculteurs pilotes et de leurs conseillers de chambre d’agriculture ou de coopérative, avec l’encadrement méthodologique de l’Inrae et d’Agro-Transfert. Un atelier a été organisé pour chaque agriculteur. Suite à l’atelier, l’agriculteur finalisait, lors d’un entretien avec son conseiller, un prototype d’assolement économe en azote sur le long terme. Cet accompagnement stratégique s’est prolongé avec des mesures de terrain, l’analyse des résultats obtenus chaque année, et si besoin un réajustement pour la campagne suivante.
Le service Solutions agricoles de Cérésia, qui accompagne techniciens et adhérents, s’est appuyé sur l’expérience acquise dans AUTO’N pour faire bouger les lignes. « Cela permet de préparer l’avenir, estime Frédéric Adam. La nécessité d’une approche globale fait son chemin, de même que la façon de réfléchir avec l’agriculteur pour l'associer dans la prise de décision. Du point de vue technique, l’optimisation de la fertilisation azotée est devenue un axe fort : nous travaillons sur l’utilisation des couverts, des légumineuses, de la matière organique, et sur le positionnement des apports pour une meilleure valorisation. Nous avons découvert des outils à développer en routine et nous disposons de nouvelles connaissances pour répondre aux agriculteurs qui s’interrogent. »